« Pourquoi êtes-vous là toute seule à pleurer quand tout le monde est allé assister à la réception de l’évêque et de son frère le capitaine ?
— Je suis infirme et je ne peux pas marcher, señora. Qu’ai-je à voir avec tous ces gens bien portants et heureux ? »[1]
En perdant l’usage de sa jambe, Catalina perd aussi le goût de se mêler aux autres, les heureux bien-portants. Elle perd aussi son fiancé, qu’un miracle lui rendra pourtant. Au drame physique s’est ajouté le drame social, moins dû à son infirmité qu’à la manière dont les autres l’estiment et la regardent. Ce second mal n’est-il pas artificiel ? Ne suffirait-il pas que la société changeât son regard sur cette infirmité pour qu’il disparaisse ? Cette idée explique l’étonnant développement ces dernières années, à peu près partout dans le monde, de programmes de sensibilisation et de rééducation à destination des valides : combattre l’exclusion des « handicapés », corriger les préjugés, lutter contre les stéréotypes. Bref, déstigmatiser l’infirmité. Tout ça paraît partir d’un bon sentiment, et pourtant, à y regarder de plus près, la bonté est souvent plus apparente que réelle. Que vaut la bonté revendiquée du marchand de miracles, qui a toujours gravité autour des invalides en faisant commerce de leur détresse ? Est-il évident que ces programmes vont beaucoup plus loin que ces charlatans ? C’est vrai, ils s’appuient généralement sur les « derniers travaux de la sociologie », aujourd’hui labellisés Disability studies, qui prétendent justifier ces stratégies par une vision scientifique de la sociologie du handicap. Mais que vaut cette sociologie ? En dernière instance, elle sort toute entière d’une même source, publiée par Erving Goffman en 1963 et traduite sous le titre Stigmates[2]. Et paradoxalement, cet ouvrage beaucoup plus subtil que ses innombrables rejetons, contient en lui-même une critique radicale de ces programmes de sensibilisation. Car, en réalité, ils éduquent qui, ces programmes, le valide, ou l’invalide ? Leur but est-il vraiment l’assistance publique des infirmes, dans la tradition révolutionnaire française ? N’est-ce pas plutôt la déculpabilisation des valides ? Leur salut moral ? La lecture du classique de Goffman nous donne quelques clés pour y voir plus clair et comprendre ce que disent de la violence de notre époque ces programmes de déstigmatisation.
Lire la suite

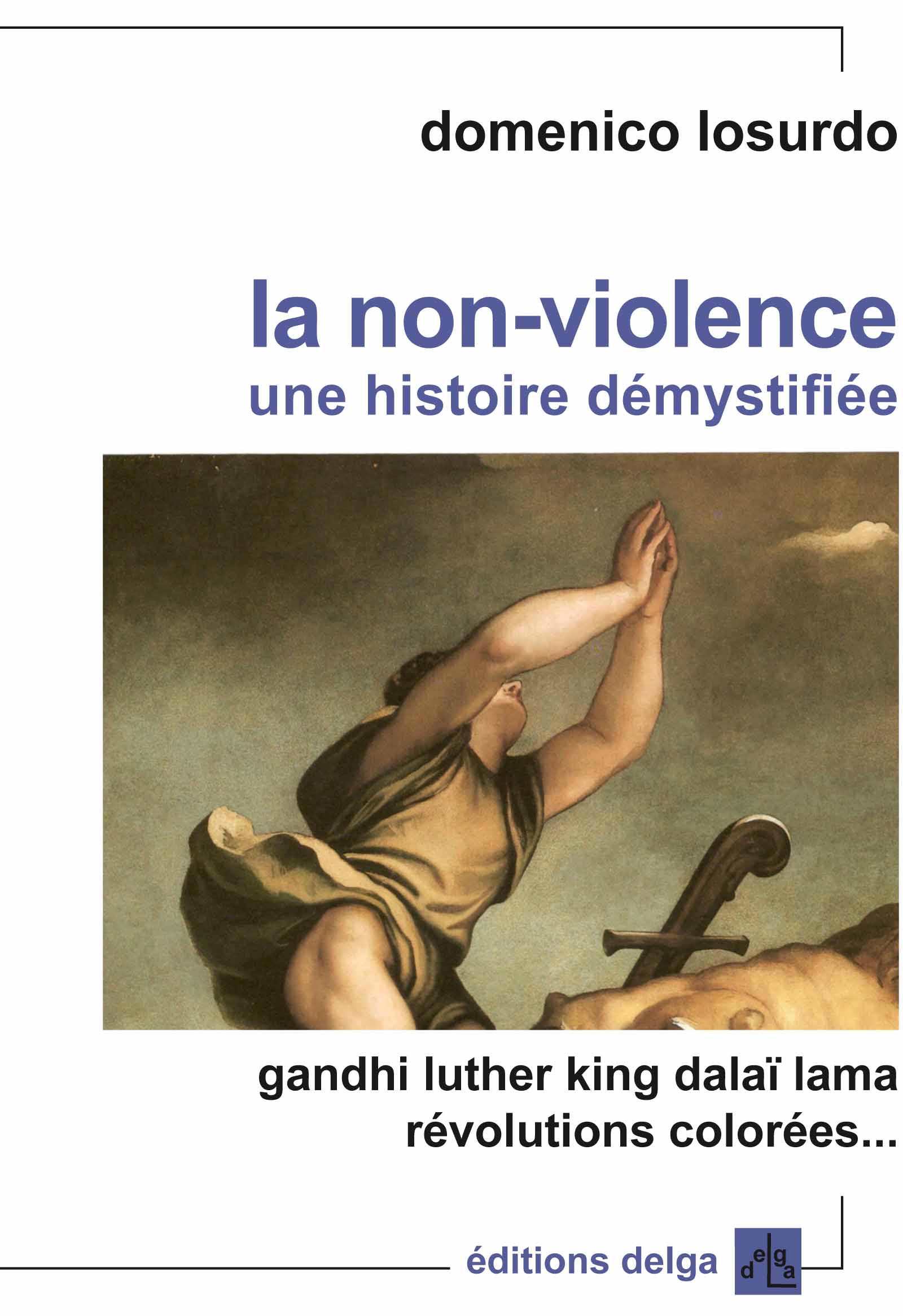 Emmanuel Macron, le 22 novembre 2019 à Nesle : «
Emmanuel Macron, le 22 novembre 2019 à Nesle : « 


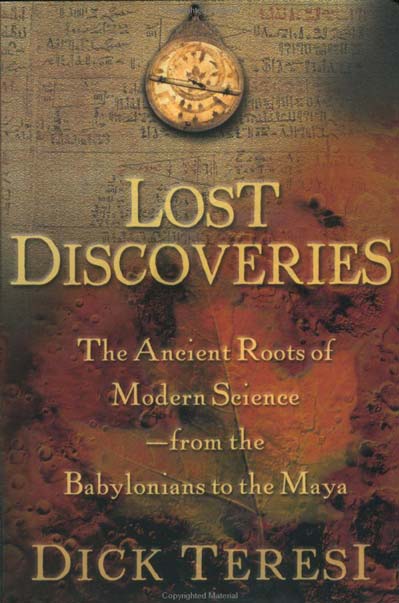 Lost Discoveries : The Ancient Roots of Modern Science—from the Babylonians to the Maya, par Dick Teresi
Lost Discoveries : The Ancient Roots of Modern Science—from the Babylonians to the Maya, par Dick Teresi